Depuis de nombreuses années, l'hôpital public subit la baisse constante de moyens et l'augmentation du poids des tâches administratives au détriment du soin. Les médecins et soignants doivent faire toujours plus avec toujours moins. Les situations d'épuisement professionnel, de burn-out, voire de suicides se multiplient. Ceux qui tentent tant bien que mal de faire leur métier de manière consciencieuse et humaine s'exposent au risque d'être « moins rentables » que les autres, ce qui conduit à des situations de harcèlement et de maltraitance institutionnelle. C'est dans ce contexte que les signalements abusifs se multiplient.
Du manque de temps à la perte de sens
Signaler permet d'aller au plus vite et de ne pas faire l'effort de rechercher des causes médicales rares. Lorsqu'Emi demandait pourquoi le signalement avait été fait sur son fils alors qu'une cause médicale était envisagée, on lui a répondu qu'un « signalement coûte moins cher à la sécurité sociale qu'une recherche de maladies rares ». Pire, accuser les parents de maltraitance permet parfois de cacher des erreurs médicales flagrantes.
Les soignants se plaignent aussi de passer de moins en moins de temps avec les patients. Moins de temps pour les écouter, moins de temps pour les accompagner, moins de temps pour les soigner correctement.
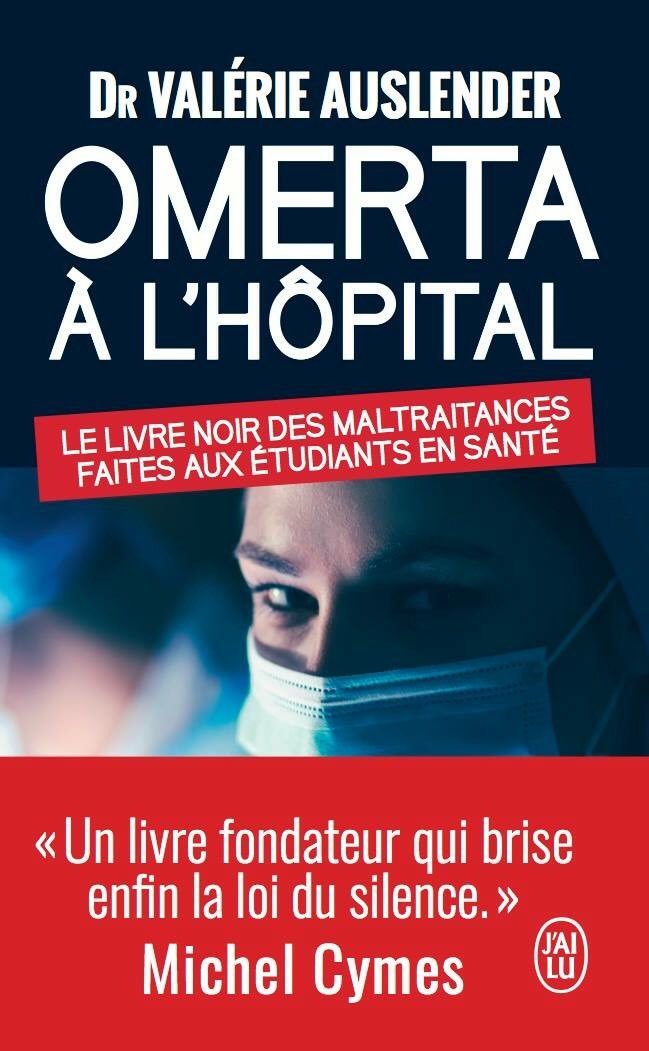 Dans son livre « Omerta à l'hôpital », Valérie Auslender rapporte le témoignage d'une ancienne étudiante en soins infirmiers. Un jour, cette étudiante s'occupait d'une patiente en fin de vie. Alors qu'elle écoutait cette patiente en pleurs en lui tenant la main, sa supérieure rentra soudainement dans la chambre et lui ordonna de sortir. Elle lui interdit de recommencer, car « une infirmière doit se contenter de faire ce qu'on lui demande, rien de plus. » Pour cette étudiante, qui a finalement arrêté ses études par dégoût avant de devenir caissière :
Dans son livre « Omerta à l'hôpital », Valérie Auslender rapporte le témoignage d'une ancienne étudiante en soins infirmiers. Un jour, cette étudiante s'occupait d'une patiente en fin de vie. Alors qu'elle écoutait cette patiente en pleurs en lui tenant la main, sa supérieure rentra soudainement dans la chambre et lui ordonna de sortir. Elle lui interdit de recommencer, car « une infirmière doit se contenter de faire ce qu'on lui demande, rien de plus. » Pour cette étudiante, qui a finalement arrêté ses études par dégoût avant de devenir caissière :
Je crois que plus on entreprend ces études avec du cœur et moins on est susceptible de réussir. (...) Le monde médical devient plus un monde de business qu'un monde humain et je trouve cela triste.
Pour une externe qui témoigne dans ce livre :
Je souffre du peu d'humain qu'on retrouve dans nos stages. L'hôpital doit tourner vite sans jamais perdre de temps. On est aveuglé par les protocoles et les listes de choses à faire. J'ai failli arrêter mes études de médecine l'an dernier à cause de ça. Je ne retrouvais plus dans ma formation la raison pour laquelle j'avais voulu commencer.
Toujours dans ce livre, le psychiatre Christophe Dejours, spécialiste de la souffrance au travail, analyse ce phénomène par la « montée en puissance des gestionnaires et des administrateurs, qui ont délogé les médecins de leurs prérogatives » :
Le plus important au niveau du travail des soignants, c'est la nécessité de travailler sous une pression accrue des cadences du travail de soin, la concurrence entre temps consacré au travail de soin proprement dit et temps consacré aux tâches d'enregistrement des données, de codification, de reportings, pour fournir aux gestionnaires les données quantitatives à partir desquelles ils entendent « piloter » l'hôpital.
Au plan du soin, de facto, la qualité se dégrade sous la pression de la quantité. Dans de nombreux services aujourd'hui, les soignants sont conduits à bâcler le soin pour tenir les objectifs quantitatifs. On doit souligner qu'on retrouve exactement le même processus au niveau de la magistrature qui est obligée, pour tenir les objectifs de cadence, de flux et de performances, de bâcler de plus en plus souvent la qualité du travail juridique proprement dit.
Cette pression expliquerait-elle aussi la tendance de certains magistrats à décider des placements systématiques sans étudier les dossiers en détail, sans peser le pour et le contre, et sans prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant ? Expliquerait-elle la tendance de certains experts à appliquer des critères aveuglément sans prendre en compte l'intégralité du dossier médical dans toute sa complexité ?
Un processus de déshumanisation
Dans un environnement aussi dur et concurrentiel que celui de l'hôpital, on peut comprendre que ce contexte conduise à sélectionner les soignants les moins empathiques, ou pousse certains professionnels à perdre cette humanité qui fait pourtant le cœur de leur métier.
Pour un externe en médecine qui témoigne dans « Omerta à l'hôpital » :
On nous fait disséquer des morts en médecine. Ceux qui ont des réactions finalement normales face à des cadavres en décomposition, sont « des faibles ». Pour être fort, il ne faut surtout pas être empathique, ne laisser paraître aucune émotion, ne plus être humain en somme. (...)
Un médecin raconte également :
Tout au long de ma scolarité, j'ai ressenti que l'objectif des enseignants n'était pas de m'intéresser à mon futur travail, ni de m'accompagner dans mes acquisitions, ni de me sensibiliser à l'être humain qui est mon patient. Mais bien de m'endurcir et de vérifier que j'étais capable de soutenir la pression psychologique très intense à laquelle mon métier allait me soumettre. Il ne croyaient pas avoir tant raison. Je pense que les jeunes Marines ressentent ce que j'ai ressenti pendant ma scolarité, à ceci près que je suis ne suis pas devenu un soldat mais un soignant supposé capable d'empathie, d'écoute, d'adaptabilité, de réflexion humaine. (...) Parce que nous sommes élevés comme des chiens de guerre et non comme des soignants, nous ne sommes pas à l'écoute de nous-mêmes, pas à l'écoute des uns des autres et moins que tout, à l'écoute des patients.
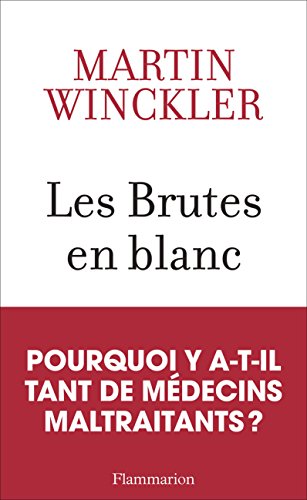 Pour Martin Winckler, un médecin généraliste qui a décrit dans son livre « Les brutes en blanc » le comportement inacceptable de certains médecins :
Pour Martin Winckler, un médecin généraliste qui a décrit dans son livre « Les brutes en blanc » le comportement inacceptable de certains médecins :
Beaucoup d'étudiants se désensibilisent et perdent leur empathie. Les causes sont multiples : le stress professionnel, la tempête de sentiments devant l'intensité de la souffrance humaine et leur impression d'impuissance à la combattre sont facteurs de burn-out, lequel est suivi d'un repli émotionnel destiné à les protéger. (...)
[Cela explique] que de nombreux praticiens apparaissent comme « insensibles » ou « à peine concernés » par ce que les patients leur disent. Cette insensibilité affichée est, le plus souvent, une posture défensive. Réagir, c'est montrer qu'on est touché. C'est un signe de faiblesse. Or, on enseigne aux médecins qu'ils doivent être forts puisque les patients sont faibles.
Un médecin qui n'écoute plus le patient est un médecin qui ne veut pas entendre les inquiétudes des parents qui emmènent leur enfant à l'hôpital, un médecin qui ne croit pas les explications des parents sur l'origine des lésions, un médecin qui croit, comme le Dr House, que « tout le monde ment », un médecin qui soupçonne in fine chaque parent d'être potentiellement maltraitant.
Soignants maltraités, patients maltraités
Pour Christophe Dejours, le soignant devient alors insensible à la souffrance de l'autre. Le soignant devenu maltraitant malgré lui souffre néanmoins lui-même :
Ainsi en arrive-t-on souvent à des situations pénibles pour les soignants, qui consistent sous la pression de l'évaluation quantitative, à céder sur la qualité, à maltraiter les patients et les familles, et en fin de compte à apporter leur concours à des pratiques que le sens moral réprouve. S'ouvre ici le domaine de la « souffrance éthique » : à force de déroger aux règles de métier, on finit par trahir l'ethos professionnel et bien souvent la déontologie. Puis à se trahir soi-même. Ce qui ouvre la porte à la dégradation de l'estime de soi, à l'effondrement des bases éthiques de la personnalité, à la dépression, et parfois au suicide, lorsque la trahison de soi dégénère en haine de soi.
Le clivage entre leur comportement indigne dans leur travail, et leur fonctionnement irréprochable dans la sphère privée, se fait au prix d'une rationalisation secondaire : « on ne peut pas faire autrement », « il faut réduire les coûts », « les états d'âme, c'est du passé. Ici on n'a pas le temps pour ça » :
Ce type de formules toutes faites, de slogans, de mots d'ordre, de propos à la hauteur du café de commerce, ne sont pas le résultat de l’élaboration d'une pensée personnelle de chaque soignant. Ils sont mis à disposition par les cadres, qui les répètent inlassablement, après les avoir appris dans des séminaires de formation de cadre.
Nous connaissons aussi les formules toutes faites, comme le signalement qui est décidé par « principe de précaution », le placement qui est ordonné pour « le bien de l'enfant » ou « parce qu'on n'a pas le choix ».
Quant à eux, les soignants qui résistent ne sont pas moins en souffrance :
Les récalcitrants parmi les soignants sont impitoyablement harcelés, jusqu'à ce qu'ils demandent leur mutation ou donnent leur démission. Pendant ce temps, les autres plient sans rien dire et deviennent des collaborateurs de la maltraitance. Et pourtant quand l’organisation du travail précédente le permettait, ils étaient des soignants impliqués, attentifs, travailleurs, et généreux. Mais sous la pression du nouveau management à la menace, ils se sont clivés et deviennent des collaborateurs du pire.
Revenons maintenant à la question du signalement. Un médecin doit-il signaler une suspicion de maltraitance, mais pour laquelle une cause médicale pourrait probablement être retrouvée avec les examens appropriés ?
La loi oblige le professionnel à signaler « dans le doute », et la loi protège le médecin qui signale de bonne foi. D'un autre côté, un médecin peut hésiter à lancer une procédure qu'il sait le plus souvent destructrice pour toute la famille, surtout si une cause médicale reste possible ou probable.
Ainsi, seules des considérations éthiques et humaines peuvent faire hésiter le médecin. L'un des principes fondateurs de la médecine est : « d'abord, ne pas faire de mal ». Or, lorsqu'un environnement violent et maltraitant sanctionne sévèrement les comportements humains et déontologiques, ces derniers disparaissent et plus rien n'empêche les signalements de se multiplier. Cela expliquerait-il l'explosion des signalements injustifiés au cours des dernières années ?
